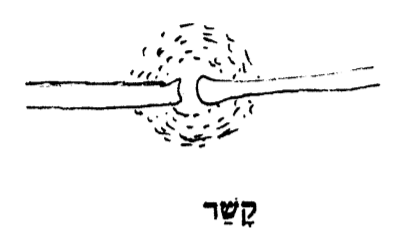Un matin d’hiver. Le téléphone sonne. L’autre bout du fil, une voix féminine me demande si j’accepterais de participer à un congrès au Sénégal à la fin du printemps. Ce matin-là, je me demandais comment je parviendrais à noircir mon papier et j’étais à mille lieux de savoir si un voyage en fin de printemps me tentait. Comme le coup de fil venait de Dafna Golan, la directrice du département des relations culturelles du ministère des Affaires étrangères, j’ai opté pour une réponse diplomatique, commençant par demander des renseignements sur le Sénégal, sur le congrès organisé par le Forum des médias et de la culture sur le thème : « Rôle et apport des journalistes, écrivains et éditeurs au développement de la culture de la paix ». J’ai rétorqué que j’allais y réfléchir.
Ce que j’avais lu et entendu sur l’hospitalité légendaire des Sénégalais, leur musique, leur littérature, leur poésie, a fini par me décider. D’autant que les messages reçus de Doron Grossman, l’ambassadeur d’Israël à Dakar, soulignaient l’importance accordée à l’invitation d’un représentant Israélien. C’est que depuis 1995, les pays d’Afrique noire ont renouvelé leurs relations diplomatiques avec Israël, après la longue interruption qui, sous la pression des pays arabes, avait suivi la guerre de Six-Jours.
Je profitais de mon passage à Paris pour faire l’acquisition, dans une librairie spécialisée, d’ouvrages de recherche et surtout de recueils de poésie et de romans sénégalais : les poèmes de Léopold Sedar Senghor, les romans de Mariama Ba, d’Aminata Sow Fall, de ae célèbre romancière féministe Ken Bugul, du réalisateur et écrivain Ousmane Sembène. Quant à ma préparation psychique, elle se faisait à son rythme. Je savais que ma mission au Sénégal – la première de ma vie dans un pays d’Afrique noire, serait celle d’un écrivain, mais celle aussi d’une femme et d’une mère. Peut-être était-ce le souvenir de cette robe de grossesse de couleur indigo acheté il y a des années chez une couturière ivoirienne ; peut-être ce souvenir procédait-il de mon admiration pour la fécondité des femmes africaines. Peut-être aussi de mes voyages imaginaires en Afrique droit venus de tréfonds « africains » ignorés transcrits dans une nouvelle traitant de mythes féminins exacerbés dont, à ma grande surprise, j’ai fini par trouver de tangibles échos pendant mon séjour au Sénégal…
La particularité de ce Forum tient aux échanges entre journalistes, les poètes et les écrivains. Particulièrement impressionnante est ici cette profonde et authentique faculté d’écoute du poète, de son message personnel et élaboré. Une voix qui dénonce ou qui console, une voix ponctuée de rêve, de mémoire et d’instants fugitifs.
J’arrivais donc à Dakar à la tombée de la nuit : murmure de l’océan sombre qui parvient au balcon de ma chambre d’hôtel, premières impressions matinales sur les trottoirs bondés, les taxis bringuebalants. Des rues où le vieux côtoie le neuf, le luxe la misère. Dans la luminosité de la saison sèche, taches de couleur des costumes multicolores, senteurs des arbres en fleur. J’arrive devant le bâtiment où se tient le « Forum sur les médias et la culture ». Dans la salle de conférence, comble, un public tendu, hétérogène. Haut patronage du président de l’état, présence de ministres, couverture médiatique continuelle. Expression grave des visages des participants. Débats sur la guerre et la paix, d’autant plus acerbes que nous sommes en Afrique, ce continent déchiré par des guerres fratricides, par la purification ethnique, si éloigné de la bonne conscience occidentale. Laquelle se contente, dans la plupart des cas, de donner le change pour se disculper des bénéfices qu’elle tire des ressources naturelles de ce continent et de ses ventes d’armes, après des siècles d’esclavage et de féodalisme colonial. Une Afrique où la violence fait des ravages en Sierra-Leone, en Angola ; qui croupit sous le poids de la corruption de ses classes dirigeantes. Une Afrique accablée par la famine, par le sida. Une Afrique qui est toujours la proie du colonialisme occidental, dans sa version moderne : l’économie et la culture du village global. L’expose de faits, des débats houleux. Des voix qui s’élèvent de la capitale du Sénégal, l’un des pays les plus progressistes du continent africain, un îlot d’espoir en la stabilité du régime démocratique, en la justice sociale.
La particularité de ce Forum tient aux échanges entre journalistes, les poètes et les écrivains. Particulièrement impressionnante est ici cette profonde et authentique faculté d’écoute du poète, de son message personnel et élaboré. Une voix qui dénonce ou qui console, une voix ponctuée de rêve, de mémoire et d’instants fugitifs. Une voix que l’Afrique n’a pas encore étouffée par souci de rentabilité commerciale ou de taux d’écoute. Peut-être est-ce le sillage laissé sur cette terre par Senghor, poète et premier président du Sénégal. Peut-être est-ce au fond le vrai visage, profondément humain, de l’Afrique tout entière ? C’est cette même vigueur, cette même empathie spontanée qui a permis, dans l’Afrique du Sud chrétienne, de mettre sur pied une commission « Vérité et Réconciliation » imprégnée de la foi en la capacité de dialogue entre les partisans de l’apartheid et les familles de leurs victimes. L’affrontement des bourreaux et des martyrs, qui est à la fois un aveu et une demande de pardon. Foi en le pouvoir d’une concertation fraternelle, en le pouvoir de guérir les âmes des citoyens d’une même nation.
Quelquefois, attentive aux propos des orateurs, je contemplais par la fenêtre les bateaux du port, les scènes de rue. Les étals croulants sous les paniers d’osier, les étoffes, les bijoux, le rire retentissant sur les marchés des passants abrités à l’ombre, leurs chants, leurs danses. Cette fabuleuse vitalité de Dakar, qui me collait de plus en plus à la peau. D’autres fois, mes pensées m’emportaient vers mon pays, Israël. Face à ce continent aux peuples innombrables, à ces pays dont les frontières artificielles ont été fixées par les Européens, à ce Sénégal, dont les 95 % des habitants sont fidèles à un islam modéré, je m’interrogeais, sur cette autre constellation, celle de mon pays pris entre les feux croisés de l’Occident et de l’Orient, du conflit israélo-arabe, du sort des cultures minoritaires, des réalités modernes du village global. Et puis, je revenais au Forum, et me repaissais des échanges d’opinions, de la chaleur humaine et du goût puissant des jus de fruits multicolores : le jaune, jus du fruit du baobab ; le rouge, de baies locales ; le vert, si rafraîchissant, qu’au terme d’efforts conjugués nous sommes parvenus à définir de « sorte de coing ».
Déléguée Israélienne, j’ai été particulièrement touchée par les sentiments d’amitié et de communauté de destin qu’éprouve l’Afrique noire à l’endroit du peuple juif. Des sentiments qui ne sont pas ternis par les ressentiments du colonialisme et de l’esclavage qu’éveillent ici les Blancs. Les intellectuels africains que j’ai rencontrés connaissaient bien les problèmes d’Israël, depuis les détails du conflit israélo-arabe dont ils n’ignorent rien des aléas, jusqu’aux difficultés d’insertion vécues par les Juifs Éthiopiens (auxquels ils s’identifient avec fierté). J’ai eu aussi la surprise de constater l’admiration qu’ils vouent au peuple juif, leur solidarité avec ce peuple qui a connu tant de souffrances et de persécutions, qui a bâti sa patrie et l’a doté d’une armée et de rouages économiques modernes, et qui, en même temps, est parvenu à préserver à travers les âges sa spécificité culturelle et linguistique.
Une preuve de cette fraternité m’a été donnée au cours de ma visite à la « Maison des esclaves » dans l’île de Gorée, au large de Dakar. Une structure massive, de couleur brique, comme la plupart des édifices de cette île, et qui est un mémorial de l’esclavage. Au premier étage sont reconstituées les résidences cossues des marchands d’esclaves ; au sous-sol, les cellules infâmes aux parois aveugles destinées aux esclaves, où se pressaient des milliers de Noirs enchaînés avant leur descente aux enfers, quand ils étaient précipités vers la « porte sans retour », celle d’où ne revient plus, vers les soutés des vaisseaux, autrement dit vers l’esclavage, souvent la mort. Sur le mur d’entrée de la Maison des esclaves, creusée dans la pierre, cette inscription révélatrice: « Dachau africaine ». C’est cette inscription qui m’a donné le courage d’évoquer publiquement ce que j’ai appris de ma mère, rescapée des camps de la mort.
Autre élément de cette connivence qui lie les Africains à Israël et que je dois à Cossi Guenou, poète togolais venu prendre place à mes côtés à un repas : de son visage ouvert au menton pointu et au regard malicieux, il m’a raconté avec émotion les impressions retirées de son séjour d’un mois en Israël. En visite privée, il avait visité la région du lac de Tibériade, Jérusalem, et avait joue du tam-tam à l’église d’Abu-Gosh. Il y avait dans sa voix de la nostalgie pour ce qui appelait « les racines juives primitives » de l’Afrique, pour ce berceau de la civilisation universelle puisée en Égypte. Curieusement, il était à la recherche de ses racines « juives », et je m’en rendis compte au cours de nos rencontres. Avec pudeur et humilité, il m’a montré un de ses recueils de poèmes pour enfants. Des poèmes dépouilles, truffes de références à la littérature populaire, un peu comme ceux de Garcia Lorca. Et je me disais qu’un jour peut-être les petits Israéliens s’endormiraient au son des poèmes de Cossi Ghenou : sur cette lune pointant au-dessus de la hutte où s’endort un enfant que bercent, par la voix de sa mère, des oiseaux et des tigres.
À la fin de ma prestation au Forum, un évènement surprenant et tellement révélateur des liens qui nous unissent : je suis une Juive pratiquante, ce qui, dans les cercles intellectuels israéliens me transforme souvent en une espèce de Métèque. Et qui, à Dakar, a donné lieu à une touchante expression d’identification. Le programme du congrès prévoyait une pièce de théâtre le vendredi soir. J’expliquais aux organisateurs que malgré mon désir de m’y rendre, la chose m’était impossible, ne circulant pas le chabbat, mais que j’irai au théâtre à pied. Désarroi de mes interlocuteurs, car le théâtre en question se trouve à l’autre bout de la ville, à une distance de plus d’une heure à pied. Après de longs conciliabules, on me fait avec enthousiasme une proposition : mettre à ma disposition une calèche, voire un cheval, de sorte que je n’aurai pas à y aller en voiture. Moyens de transport exotiques certes, mais qui, dans mon cas, ne résolvaient pas le problème. Le président de séance, après s’être lancé dans des explications sur le chabbat, fit solennellement la déclaration suivante : « Je viendrai demain à pied avec vous ». Dans la foulée, les participants au Forum se sont levés comme un seul homme pour déclarer l’un après l’autre que lui aussi, elle aussi, viendraient à pied avec moi. Si j’avais une mentalité de gourou, ou de rabbin de Loubavitch, et si la pièce de théâtre en question m’avait réellement tentée, je me serais retrouvée traversant les rues de Dakar un vendredi soir à la tête d’une « Marche de la paix du Shabbat ». Que dire aussi de la longue interview d’une heure à la radio « Sud F.M. », déplacée pour les mêmes raisons au samedi soir, après le chabbat, et que le présentateur a introduite par une explication spéciale concernant le Chabbat. J’avais un peu l’impression de me trouver en plein rituel de Melaveh Malka (rituel d’escorte associé au « départ » de la Reine-Chabbat) diffusé en l’occurrence à partir du café Metissacana pour des auditeurs africains.
Ce que mon voyage au Sénégal m’a incontestablement révélé de plus pénétrant, ce sont les femmes, les mères, les jeunes filles. Elles sont les chefs de famille de cette société polygame où les enfants sont identifiés à leurs mères, partagent leur destinée, leur obéissent au doigt et à l’œil. Elles sont la voix du cœur, de la morale et de l’intransigeance. Comme dans le Pacte « Vérité et Réconciliation » d’Afrique du Sud, où les mères et les sœurs des victimes sont celles à qui la repentance des bourreaux s’adresse.
Mon vrai voyage au Sénégal a commencé au moment où, quittant un environnement qui m’était devenu familier, j’ai rencontré l’inconnu : les vagues de l’océan Atlantique qui viennent s’échouer sur les plages de la ville, le port de pêche, le lac Rose et ses berges aux huttes pointues, l’ensorcèlement des forêts de baobabs. Le foisonnement humain des rues et des marchés de Dakar, cette propension naturelle à engager la conversation, à se prendre d’amitié. Le foisonnement des articles en vente : tout ce que l’on peut imaginer, des boëtes d’allumettes aux ventilateurs à pied, en passant par des cassettes et des mangues. Le foisonnement de musique qui retentit jour et nuit. Le martèlement des mains sur les caisses du marché, le battement des tambours, les chants des hommes et des femmes. Les sonorités portugaises et créoles. Le wolof sous toutes ses formes et toutes ses tonalités. Les sons qui surgissent des gorges des gens qui se retrouvent sur les trottoirs, des transistors, des boutiques, des haut-parleurs des cours intérieures et des cassettes des marchands ambulants.
Et l’acmé de mon voyage : mes contacts avec les femmes du Sénégal. Superbes dans leur beauté naturelle, dans leur rayonnement vibrant. Écrivains ou ouvrières, marchandes de bijoux ou mendiantes, elles passent de leur démarche hautaine et chaloupée, légère, royale, le corps élancé et harmonieux, revêtues de boubous aux infinies impressions multicolores, de leurs turbans artistement noués et savamment disposés sur le haut du crâne, aux franges tressées semblables à des fleurons de couronne. Les connaissances de l’ambassadeur d’Israël en matière culturelle m’ont donné de passionnantes occasions de rencontres avec des femmes artistes, des chercheuses, des dirigeantes, qui m’ont révélé les secrets de la femme sénégalaise, sa personnalité exceptionnelle, son statut dans la société environnante. J’ai partagé avec elles ma conviction que c’est la voix des femmes, des mères qui doit s’élever contre la guerre. La sincérité profonde du dialogue entame avec la juriste Amatou Sow Sidibé qui, à l’arrière de son sourire chaleureux, savait découper au scalpel la chair des réalités africaines, les faiblesses du régime, la lutte pour la défense du statut de la femme. Le dialogue avec Aminata Sow Fall dont le roman La Grève des Battu soulève avec une ironie caustique l’attitude ambivalente à l’égard des mendiants – ceux qui reçoivent l’aumône prescrite par l’islam – et qui remplissent les rues de Dakar. Au cours d’un charmant repas chez elle, elle a raconté le tollé soulevé par ses premiers ouvrages, où des passages en wolof sont combinés au français. Elle a décrit sa première visite en Israël, dont l’apogée a été pour elle une prière a la mosquée d’El-Aqsa, le goût délicieux des pastèques de mon pays. Le repas s’est achevé sur le goût enivrant des mangues cueillies dans son jardin (comment s’émerveiller du goût des pastèques après celui de ces mangues ?) et sur la lecture d’un poème qu’elle avait écrit en souvenir de sa mère. Elle a fait passer entre les mains de ses hôtes le portrait d’une femme à la peau particulièrement foncée, à l’expression sévère, aux mâchoires serrées, au visage carré enturbanné, dont le regard perçant était lourd de souffrance.
L’amitié dont me gratifia Nyang Oumy Tauw, l’une des hôtesses du Forum à ses heures – quand elle se libérait de son travail de vendeuse dans une boutique – m’est inoubliable. Une mère de trois enfants, superbe, qui m’a procuré des heures de présence, de connivence, d’échange et de rire, en parcourant les rues et les marchés de Dakar, à la recherche de son cousin qui lui devait de l’argent pour une pièce d’étoffe de soie qu’elle lui avait procurée pour sa femme. Nous finissons par arriver au magasin de couverts jetables où il travaille, mais le bougre reste enfermé dans les toilettes et refuse d’en sortir, malgré les mises en garde d’Oumy et de ses collègues de travail. « Mais qu’est-ce que tu fabriques ? » « Je lis le journal », fut la réponse du débiteur. Suivirent des propos en wolof, ponctués des éclats de rire des personnes présentes. Il finit par en sortir, pour mieux s’enfuir. « Encore une fois, il ne m’a pas rendu mon argent », déclara Oumy, en résumant avec humour la situation.
Un moment inoubliable me fut réservé chez elle le samedi après-midi. Après avoir été présentée aux femmes âgées de sa famille, à son mari et aux amis de ce dernier, occupés à jouer aux cartes dans une pièce close réservée aux hommes, nous sommes allées dans la cour prendre part aux danses des femmes, le mbalax. Une cour étriquée, coincée entre des tas de baraques et de bâtisses. Dans un coin, le disc-jockey et sa batterie de haut-parleurs, dont la location est financée par la caisse commune de ces dames. Tout autour, des chaises de plastique blanc. Elles arrivent, seules ou en couples, revêtues de leurs robes traditionnelles, de tailleurs occidentaux, de jeans collants. Des jeunes et des moins jeunes. Des jeunes filles, des mères. Elles serrent la main de celles qui sont assises, glissent de l’argent dans la caisse commune, s’asseyent, caquètent, éclatent de rire. Sur les toits des immeubles alentour, qui semblent suspendus au-dessus de la cour, d’autres femmes contemplent la scène, y participent à distance. Et voilà les accords rythmés du disc-jockey qui retentissent. L’une après l’autre, elles se lèvent et se lancent dans d’extraordinaires rythmes endiablés. Elles ôtent d’un geste rapide leurs robes ou leurs tailleurs. Révèlent des croupes entourées de toute sorte de colliers, les binbins, qui bringuebalent au rythme de la musique, des cuisses de feu et de l’eau. Elles font vibrer la cour de leurs mouvements spontanés, à l’érotisme exacerbé, nue au plus profond, où rire et plaisir se confondent, s’excitant et s’apaisant tour à tour. Des danses dénuées de tension, de provocation, loin de la concupiscence masculine. Des danses toutes de sensualité et d’intimité féminine. Elles dansent, pour leur plaisir personnel, devant leurs sœurs assises, révélant chacune ses secrets. Elles expriment de leurs corps, de leurs gestes, ce que leur réservent leurs moments d’intimité avec leurs hommes. Passion, douleur, jouissance. Des danses qui vous touchent, vous font venir les larmes aux yeux. Toutes de féminité pure, mystique, de jubilation. Une féminité que je n’avais jamais perçue jusqu’alors.
Peu avant mon départ du Sénégal, je me suis livrée aux vagues de l’océan au crépuscule. Océan bleu, scintillant, amant secret qui m’attendait dans les baies du Sénégal. C’est dans la poésie de Léopold Sédar Senghor que j’ai trouvé l’expression de cette sensualité, dans un petit recueil bilingue (français-hébreu) paru aux éditions Equed (traduction : Aharon Amir). Un Français riche, inédit, dont le modernisme lyrique se fait la feuille de vigne posée sur le cri béant de l’Afrique. Cri qui jaillit des gorges des hommes noirs exilés, à la recherche de leur identité, perdus dans les capitales occidentales, gisant dans les cimetières anonymes des victimes de la Première Guerre mondiale. La voix de l’homme d’Afrique, qui atteint les cimes de la passion déçue, infinie ; de la femme noire, de l’Afrique tout entière :
L’Afrique vivait là, au-delà de l’œil profane du jour,
Jusqu’au pont des premières où la jeune femme, libérée des sous-préfectures et de leurs rues étroites
Libérée des dernières mesures du tango et des bras de son danseur
Rêvait, au bord du mystère, des forêts aux senteurs viriles et d’espaces qui ignorent les fleurs…
Cette voix qui m’a amenée de nuit le long de l’itinéraire qu’emprunta Saint-Exupéry dans son avion de l’Aéropostale, au-dessus de l’immensité saharienne et du littoral de Dakar, n’était pas celle du Petit Prince blanc et fragile de Saint-Exupéry, dont on fêtait le centenaire de la naissance. C’était celle, chantante, de Senghor, dans son immense poème « Femme noire » (traduit en hébreu par Arieh Lerner) :
Femme nue, femme obscure
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche
Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d’Est
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur…
Ce que mon voyage au Sénégal m’a incontestablement révélé de plus pénétrant, ce sont les femmes, les mères, les jeunes filles. Elles sont les chefs de famille de cette société polygame où les enfants sont identifiés à leurs mères, partagent leur destinée, leur obéissent au doigt et à l’œil. Elles sont la voix du cœur, de la morale et de l’intransigeance. Comme dans le Pacte « Vérité et Réconciliation » d’Afrique du Sud, où les mères et les sœurs des victimes sont celles à qui la repentance des bourreaux s’adresse. Elles, qui passent dans la rue, de leur démarche gracieuse, à l’érotisme conquérant, livrant sur leur passage le tintement des binbins qui leur ceignent les reins. Elles qui assument leur sensualité avec un formidable naturel, vebatuah qui est tout entier jouissance naturel et gai. Les Sénégalaises, en particulier celles de l’ethnie des Wolofs, dont l’intégrité corporelle et la féminité n’a jamais été menacée par un quelconque rituel castrateur. La leçon apprise des femmes africaines, de ces bastions du matriarcat, devrait attribuer cet intitulé différent, plus réaliste, plus claironnant d’espoir, au Forum de Dakar : « Rôle et contribution des femmes, des mères et des sœurs à la promotion de la paix ».
Entretemps, je garde de cette rencontre avec la teranga sénégalaise, l’inoubliable souvenir d’une merveilleuse hospitalité. La leçon exaltante de l’Afrique.